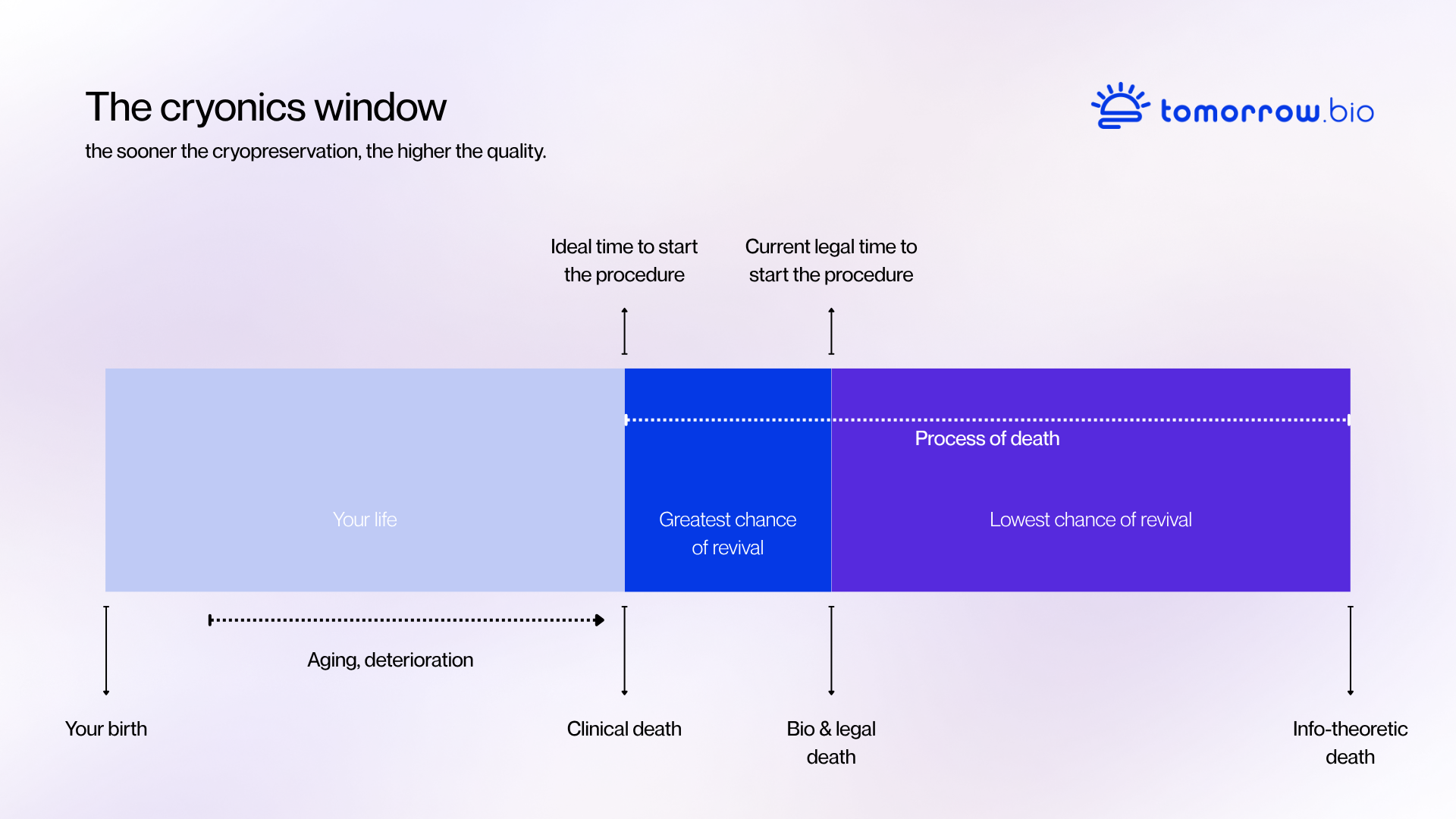La cryoconservation vise à arrêter le temps biologique. Pour ce faire, elle doit atteindre une température à laquelle le mouvement moléculaire, et donc tous les processus chimiques et biologiques qui entraînent la décomposition, cessent effectivement. Ce point se situe bien en dessous de la température de congélation de l'eau et même en dessous de la plage utilisée pour la plupart des stockages biologiques. La température de -196 degrés Celsius, le point d'ébullition de l'azote liquide, est devenue la norme parce qu'elle offre à la fois une stabilité physique et une préservation biologique à une échelle qu'aucun autre environnement ne peut offrir.
À des températures de congélation ordinaires, la formation de cristaux de glace endommage les cellules et les tissus. L'eau se dilate lorsqu'elle gèle, rompant les membranes et déformant les structures moléculaires. La cryoconservation permet d'éviter ce phénomène grâce à la vitrification, un processus au cours duquel l'eau cellulaire est remplacée par des agents cryoprotecteurs et refroidie si rapidement qu'elle se solidifie dans un état vitreux au lieu de se transformer en glace cristalline. En dessous d'environ -130 degrés Celsius, la température de transition vitreuse, cet état vitrifié se fige. À ce stade, le mouvement moléculaire et les réactions chimiques ralentissent à tel point que le matériel biologique devient effectivement intemporel.
Il est essentiel de maintenir la stabilité en dessous de ce seuil. Si les températures s'approchent trop du point de transition vitreux, la structure vitreuse pourrait se détendre partiellement ou se recristalliser, ce qui entraînerait des dommages. En conservant le matériel préservé à -196 degrés Celsius, le système reste bien en deçà de cette limite, ce qui offre une grande marge de sécurité et garantit que les tissus vitrifiés restent structurellement stables indéfiniment.
L'azote liquide est utilisé pour atteindre et maintenir cet environnement parce qu'il est à la fois naturel et remarquablement efficace. Lorsqu'il bout, il maintient une température constante de -196 degrés Celsius, constituant ainsi un tampon thermique autorégulé. Cela permet au stockage cryogénique de rester stable sans réfrigération active ni électricité. Les patients et les échantillons biologiques sont conservés dans des dewars isolés sous vide, qui minimisent le transfert de chaleur et ne nécessitent qu'un remplissage périodique de l'azote perdu par évaporation lente.
À cette température, la dégradation biologique s'arrête complètement. L'activité enzymatique, la croissance microbienne et les réactions moléculaires spontanées s'arrêtent. Les liens qui constituent l'architecture du corps et du cerveau restent intacts, préservant l'information codée dans leurs structures. Le choix de -196 degrés Celsius n'est donc pas arbitraire, mais reflète le point de convergence de la physique, de la chimie et de la biologie, où la matière reste stable, l'information intacte et le temps lui-même, pour le patient préservé, s'arrête.